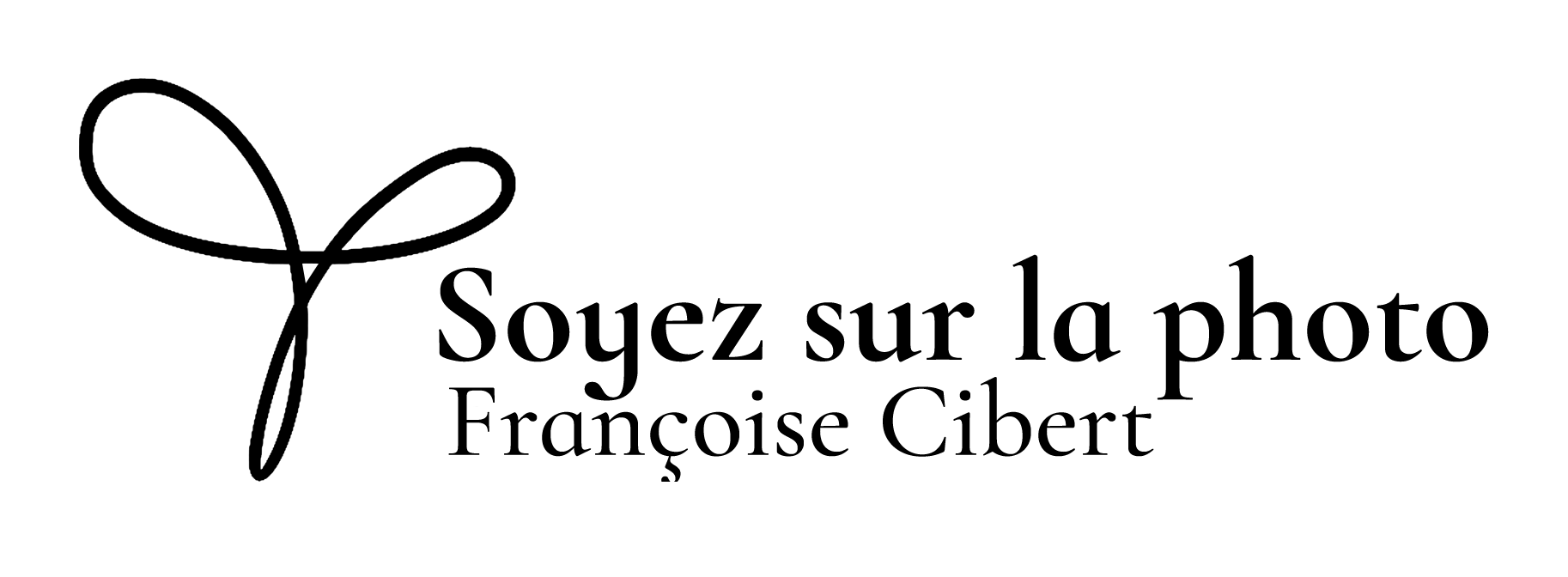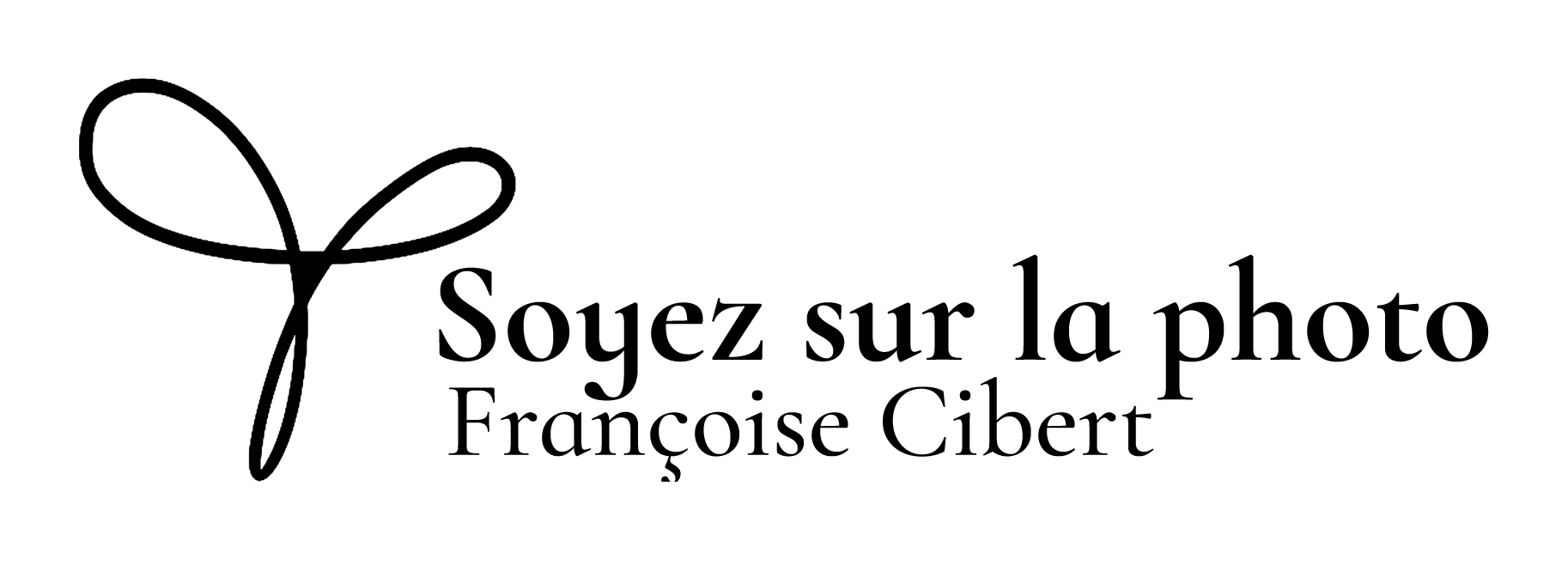LES FAMILLES SE REPRESENTENT. DEPUIS TOUJOURS.
Comment Pourquoi Evolutions.
On peut dire que les « représentations familiales » c’est la manière dont les êtres humains choisissent de se montrer, de conserver leur image, de perpétuer la mémoire de leur passage.
Les images des familles, qu’elles soient peintes, photographiées ou filmées – racontent des normes sociales, des désirs d’appartenance. Ce sont également des récits, conscients ou non autour de leur histoire.
Les représentations familiales, englobant de fait les photos de famille, se transmettent, s’associent à des fonctions symboliques, mémorielles, et entrent dans une histoire où les transformations techniques ont permis à ces représentations d’évoluer constamment.
Avant l’invention de la photographie, les représentations familiales existaient déjà, mais d’une manière à la fois très codifiée et élitiste.
Les portraits de famille peints, tels que ceux réalisés à la cour de France ou pour l’aristocratie européenne, étaient l’apanage de lignées puissantes.
La scénographie était rigoureuse : presque toujours, on disposait les personnes selon leur rang, avec des marqueurs symboliques (bijoux, attributs d’autorité, mobilier somptueux), qui soulignaient la continuité, la hiérarchie et l’histoire familiale.
Le portrait de groupe quant à lui représentait souvent des alliances matrimoniales, ces véritables arrangements dynastiques, ou des célébrations cérémonielles. Ce type de représentation était avant tout politique : il affirmait une existence sociale, une filiation, une stabilité.
Pour les classes populaires, aucun dispositif visuel comparable n’était accessible. L’image familiale restait absente. Cette absence même a eu un sens : absence de représentation dans la vie sociale, privation de reconnaissance, et surtout, absence de traces destinées à la postérité.
L’invention de la photographie au XIXe siècle, et en particulier celle du daguerréotype (années 1839–1840), change tout.
Pour la première fois, apparait une technique capable de fixer la figure humaine dans sa réalité. Le daguerréotype, produit photographique unique et fragile, offre une image réelle-réaliste– les visages captés, les vêtements et les attitudes.
Les familles, dans la bourgeoisie montante, commencèrent à faire venir le photographe dans leur salon ou se rendre dans des studios.
Les représentations étaient encore rigides, le temps de pose très long, celle-ci soigneusement scénographiée, mais elles avaient l’intérêt d’établir un témoignage visuel direct. On en trouvait surtout dans les milieux aisés, car le coût demeurait encore élevé. Puis au fur et à mesure que les procédés techniques évoluaient – calotype, collodion, plaques sèches – les tarifs baissaient, la technique se simplifiait, et l’image photographique entrait progressivement dans le domaine du possible pour les plus modestes.
Désormais, la photographie et les photos de familles deviennent un moyen de mémoire, de rapprochement entre les générations, en particulier face à des événements comme la guerre ou la maladie.
Au début du 20ème siècle, l’apparition de l’appareil Kodak Brownie, est une petite révolution. Il est commercialisé dès 1900. Simple et compact, à la portée de main de tout un chacun. Il rend possible l’“instantané familial”.
Des scènes quotidiennes – les enfants jouant leur de leur anniversaire, les repas, les fêtes, les vacances au bord de mer, les excursions dans la forêt, boussole en main– furent enfin documentées. Les albums de famille prirent leur essor.
(Qui en prenait l’initiative et la charge de sa réalisation,
qui en établissait patiemment les légendes ?)
Ces images restent empreintes de certaines conventions : les adultes impeccablement habillés, les visages relativement sérieux, les enfants un peu rigides, mais souvent ébouriffés ou avec une chaussette mal remontée.
Ces images expriment, enfin pourrait-on dire, une réalité, une vérité, comme cette mémoire collective qui se crée grâce à elles. Une partie de la population trouve là, la possibilité d’exprimer son identité, les classes populaires peuvent enfin elles aussi transmettre la mémoire de leur existence.
Ouvriers, paysans peuvent désormais avoir, puis léguer trace de leur vie.
Cela coïncide avec une époque où l’on commence à étudier le fonctionnement de la famille. Le modèle patriarcal, le père chef de famille, la mère au foyer, et les enfants en position dépendante.
Les images renforcent cette représentation. Elles sont aujourd’hui de précieux documents sociaux : elles montrent les visages de ceux qui jusque-là étaient invisibles, et permettent de se pencher sur la vie des classes populaires.
Au cours du XXe siècle, cette relation de la famille à l’image s’intensifient : les guerres mondiales, les migrations, les crises économiques. Le portrait du frère, du cousin, parti à la guerre trop jeune, fut envoyé à la famille, preuve de vie ou souvenir.
L’image des morts à la guerre, devient une relique, celle qui, déjà, nous permet de garder la mémoire. En effet le nombre de photos était très limité. Une seule photo du défunt, et de l’ami parti au loin. On mesure alors la puissance affective d’un tel objet.
Concernant les migrations, le phénomène s’inverse quelque peu. Le migrant est isolé, il reste connecté à ses racines grâce à une ou 2 photos de sa famille. On a alors un ancrage identitaire, aide précieuse lorsque tout est à recommencer, dans le nouveau monde ou ailleurs.
Avec la vidéo amateur – avec les formats Super 8 puis VHS –la représentation familiale change encore. Les anniversaires, les repas, les premiers pas, l’apprentissage du vélo. Le mouvement, l’insouciance en vacances, amplifient la charge émotionnelle de la représentation familiale. Un simple document devint une archive vivante. L’immobilité est remplacée par les rires, les gestes. Ce passage à l’image animée modifie profondément la manière dont les familles se perçoivent. Le film devient un outil d’auto-observation, de mémoire, de transmission intergénérationnelle. Les enfants d’après-guerre voient, dans les années 70 et 80, leur enfance à travers un récit, le récit subjectif de ceux qui filmaient.
L’évolution de la société progresse dans les années 70 et 80.
Elle se reflète parfaitement au travers des photos de familles. Elles sont spontanées, moins posées. Les photos dans les années 80-90 sont plus intimistes, révélant par là également le déclin du schéma traditionnel des familles.
Comme une petite révolution dans l’histoire de la photo de famille, le début du 21ème siècle déploie l’ère numérique et des réseaux sociaux. Le smartphone est devenu, pour la quasi-totalité des foyers, l’appareil unique d’enregistrement.
Il capte tout de notre le quotidien. Avec une facilité déconcertante.
Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat – autant de plateformes où tous les instants de la vie sont publiés.Réunions de famille ou amicales, naissance, anniversaire, vacances au soleil, d’animaux de compagnie et plus encore.
Changement majeur :
Ces images ne sont plus du tout destinées à conserver la mémoire privée. Elles sont vouées à être vues par le plus grand nombre.
Elles doivent démontrer notre réussite, nos modes de consommation, nos succès.
Au détriment de la sincérité et de la vérité parfois.
« Parenting », « family selfie », « holiday post », « story » – ces formats imposent des codes : le beau, le souriant, le bien rangé. Les couleurs sont lumineuses, on rit, on danse, les corps sont beaux, la joie et la bonne humeur règne parmi un groupe photographié sous son meilleur angle.
L’image devient un acte de communication bien autant qu’une trace mémorielle.
L’intimité se rend publique, mais de manière calculée. Ce glissement renvoie à l’idée que la famille – ou du moins l’image qu’on en donne – fait partie de l’identité numérique, une forme de « marque » personnelle.
Les images restent archivées, structurées par des algorithmes (Google Photos, iCloud proposent des “souvenirs”, des “rétrospectives”) ; elles deviennent une mémoire artificielle, sélectionnée, dans un récit qui n’a plus rien de réel, qui s’adapte à l’image attendue du bonheur contemporain.
On ne « partage » plus un moment familial, on le met en scène. Ce n’est pas sans questionnement pour notre capacité à vivre pleinement le moment présent. La représentation de soi prend le pas sur le vécu.
Oui la représentation familiale, la photo de famille, est prise entre deux pôles : d’un côté, l’abondance visuelle – chaque fête, repas, sortie, instant banal est capté et archivé ; de l’autre, une sélection consciencieuse – seuls les moments jugés “bons” sont partagés, les crises, les pleurs, les conflits disparaissent (soit du recueil privé, soit du récit public). On ne photographie plus seulement pour garder, mais pour montrer qui l’on est – une famille heureuse, harmonieuse, organisée.
Le selfie familial en devient un exemple emblématique : des visages alignés, des sourires, des cadrages serrés, un arrière-plan soigneusement choisi.
Comme depuis les débuts de la représentation familiale : Les images familiales définissent depuis toujours ce qu’est une “bonne famille”.
Tout change et rien ne change.
Les photos de familles établissent ce que devrait être un bon parent, la bonne posture, le bon foyer. Les médias, les publicités, les cartes postales, les œuvres cinématographiques, toutes produisent et diffusent ces images : mère au foyer idéal, père protecteur, enfant souriant, foyer propre et rangé. Ces images normatives influencent les pratiques réelles et les représentations familiales privées. Des chercheurs ont montré comment la présentation de soi (et par extension de la famille) se fait selon des conventions, un jeu social où l’apparence compte.
Dans le contexte numérique, cette recherche de perfection est encore plus accentuée, souvent inconsciente, mais loin d’être innocente.
« Soyez sur la photo » ne suit pas la tendance de la représentation « pour l’extérieur ».
Notre proposition vise à revenir à l’essentiel, à la simplicité, qui fera de votre photo un acte pérenne de transmission, interne à la famille.
Une parole mémorielle à partager au coeur de la famille.
Un autre point essentiel est celui de l’invisibilisation ou de la reconnaissance. Les familles non conformes – monoparentales, recomposées, homoparentales, transnationales, choisies– ont longtemps été peu représentées dans les images familiales ou les photos de familles.
Lorsqu’elles apparaissent, c’est souvent dans un cadre militant ou revendicateur de légitimité.
Progressivement, on constate que la norme s’élargit. Des publications, des campagnes, des réseaux montrent des familles diversifiées. Elles créent des représentations alternatives bénéfiques pour les membres concernés (légitimation, visibilité, reconnaissance sociale), et contribuent à faire évoluer les attentes collectives. Pour une famille homoparentale qui publie une fête d’anniversaire sur Instagram, l’acte n’est pas seulement de préserver un souvenir : C’est également un geste politique, un acte d’affirmation de sa légitimité.
Pour autant, l’invisibilisation perdure. Les familles pauvres, marginalisées, celles vivant l’exclusion, la pauvreté, la maladie, ou des situations d’urgence restent sous-représentées ou représentées de manière stéréotypée. Elles sont parfois instrumentalisées pour générer empathie ou culpabilité, mais ne sont pas forcément souhaitées par les personnes elles-mêmes.
Cela rappelle la dimension de pouvoir attachée à l’image : qui a la caméra ? Qui décide du cadrage ? Qui archive et diffuse ? Les représentations peuvent exclure ou amplifier certaines voix.
D’un point de vue sociologique, il est établi que l’image familiale et la photo de famille a plusieurs fonctions.
Premièrement, elle est une preuve d’existence, parle aussi des origines.
Deuxièmement, elle affiche un récit Peut être dévoilant quelques secrets par inadvertance ou observation attentive
Troisièmement, à travers l’image, l’enfant apprend ce qu’est la famille, ses codes, ses non-dits parfois.
Enfin, la photo de famille est un objet mémoriel : l’album devient un support pour raconter, transmettre, méditer sur le temps, la nostalgie, la disparition, la transmission.
Une photo de famille c’est également une histoire, toute entière racontée sur un cliché ;
Qui est à côté de qui, qui a oublié de venir ? qui sourit, qui est droit comme un I ?
Racontez vos photos de familles, racontez -les à vos proches,
c’est un outil puissant de transmission.
quelques cas illustrent à merveille la fonction mémorielle de la photo de famille.
Il y a d’une part il y a le portrait de famille royale ou aristocratique au XVIIe siècle, soigneusement peint, chargé de symboles, destiné à figurer le pouvoir, la descendance, la richesse.
Cette image a, sur le long terme, forgé notre conception de la famille “idéale” –stable, hiérarchique, unie. Elle contraste avec les photographies de famille ouvrière prises à la même époque. celles ci offrent une vision concrète de la vie de ceux qui ne pouvaient pas se représenter en famille idéale. Ces images montrent en revanche les conditions matérielles, l’entraide, la simplicité. Leur puissance réside dans leur authenticité et leur dignité.
On peut aussi considérer les images de familles séparées par la guerre.
Des portraits envoyés avant un départ au front, des photos conservées précieusement d’un disparu, deviennent des souvenir précieux. Dans les camps de réfugiés, la photo tient lieu de fil entre origines et avenir. Elle porte la mémoire oubliée, préserve le lien avec un pays quitté. Les galeries de portraits des disparus, très présentes après des conflits ou des catastrophes, prolongent cette fonction mémorielle de l’image familiale.
Dans les décennies récentes, des campagnes de plusieurs organisations militantes ont utilisé des images de familles homoparentales, de parents transgenres, de familles recomposées, parfois filmées, parfois photographiées, pour lutter contre l’invisibilité et imposer une norme plus inclusive. On y voit des visages d’enfants aimés, des repas, des parties de jeux, donnant à voir une intimité ordinaire, mais aussi revendicative. Ces images se déploient à la fois à des fins privées (partage entre proches) et publiques (réseaux, médias), et jouent un rôle d’édification sociale.
Dans un registre plus contemporain, la diffusion de vidéos de vie domestique via YouTube ou TikTok (vlogs familiaux, family challenge, ASMR de famille, routines matinales montrées au monde) illustre l’hybridation du privé et du public.
La famille comme “content”. L’intimité se vend, se monétise, se consomme. Les enfants deviennent des personnages publics, les repas des mises en scène.
Ce phénomène pose des questions éthiques considérables sur le consentement, la dignité, le droit à une enfance non instrumentalisée. Il montre aussi que l’image familiale n’est plus seulement à vocation de mémoire ou identitaire : elle est devenue un produit, un médium, un business.
Soyez sur la photo se positionne à l’inverse de ces images « forcées ».
Elle vous engage à un retour à la simplicité de votre présence, les uns avec les autres.
À l’inverse, dans certaines familles, on observe une forme de retrait : la volonté de ne pas publier, de conserver les images à usage restreint, de ne pas s’exposer. L’intimité devient chasse gardée, intérieure, non partagée. Le rejet de la performance visuelle peut constituer une forme de résistance à la norme numérique. Ces actes silencieux rappellent que l’image familiale, si elle permet beaucoup, peut aussi être intrusif ou imposé.
En définitive, l’histoire des représentations familiales, de l’époque pré-photographique jusqu’à l’ère des smartphones et des réseaux sociaux, est une histoire de transformation continue.
D’abord rare, élitiste, symbolique ; puis démocratisée, mémorielle, intime ; ensuite visant à montrer la réussite, normative, inclusive ou excluante ; finalement omniprésente, mais aussi sélective, marchande, ambivalente. À chaque étape, la technique (peinture, photographie, film, numérique) redéfinit les possibles, tandis que les évolutions sociales (modèles familiaux, migrations, inégalités, normes de genre, visibilité) déplacent les usages et les significations.
Aujourd’hui, la représentation familiale et les photos de familles se trouve à un croisement inédit : elle est universelle, accessible, visuellement quotidienne.
Pourtant, la photo de famille, ses portraits, demeure chargée de normes, de pressions, d’enjeux identitaires.
Elle peut rendre invisible autant qu’elle peut montrer.
Elle peut connecter autant qu’elle peut isoler.
Elle peut soulager les nostalgies, mais aussi imposer un récit standardisé.
La question aujourd’hui pourrait être : qu’est ce que la famille “idéale” selon les images ?
Comment se construisent les normes familiales à travers la mise en scène de soi ?
Qui garde le droit de se voir, de disparaître, de transmettre ?
Ainsi, loin d’être un simple phénomène esthétique ou documentaire, la photo de famille en tant que représentation visuelle de la famille est un acte culturel , un fait social qui nous dit, à chaque époque, qui nous sommes, comment nous voulons être vus, ce que nous voulons laisser en mémoire,
à quoi ressemble le “nous”, et qui décide du regard.
Elle incarne la tension entre volonté de permanence et réalité de l’impermanence, entre partage et retrait, entre intime et spectacle. Et sans doute, cette tension, rend ce sujet infiniment riche et actuel.